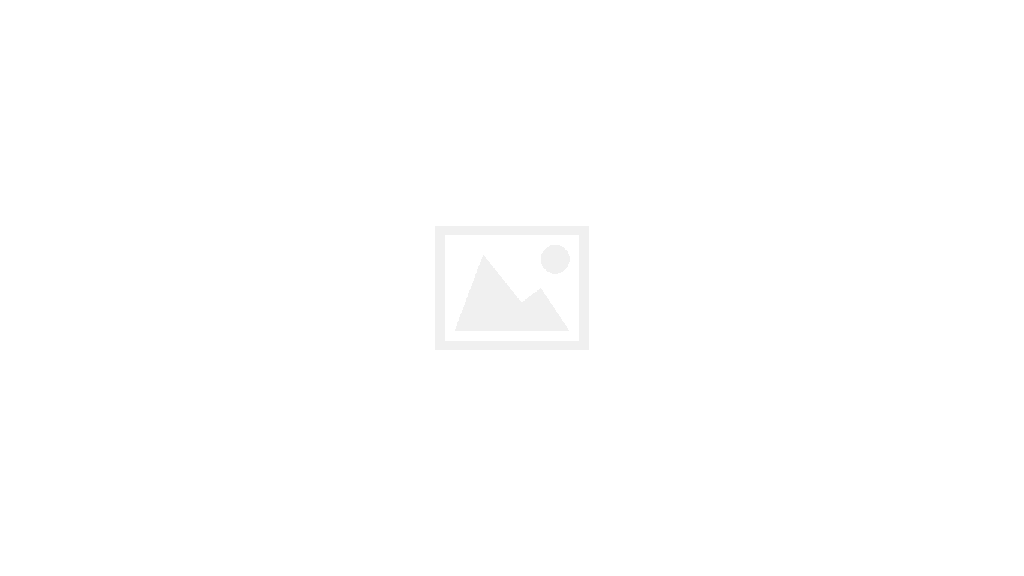Les soldats béninois en mission de paix des Nations-Unies à Kidal, au Mali ne sont pas restés en marge de la fête nationale de l'indépendance. Ils ont organisé ce mardi plusieurs manifestations folkloriques avec des démonstrations des Zangbétos et des Egun-gun s pour émerveiller leurs compagnons d'armes des autres pays, les responsables de la mission et les autorités des forces armées maliennes.
Les temps forts de cette célébration